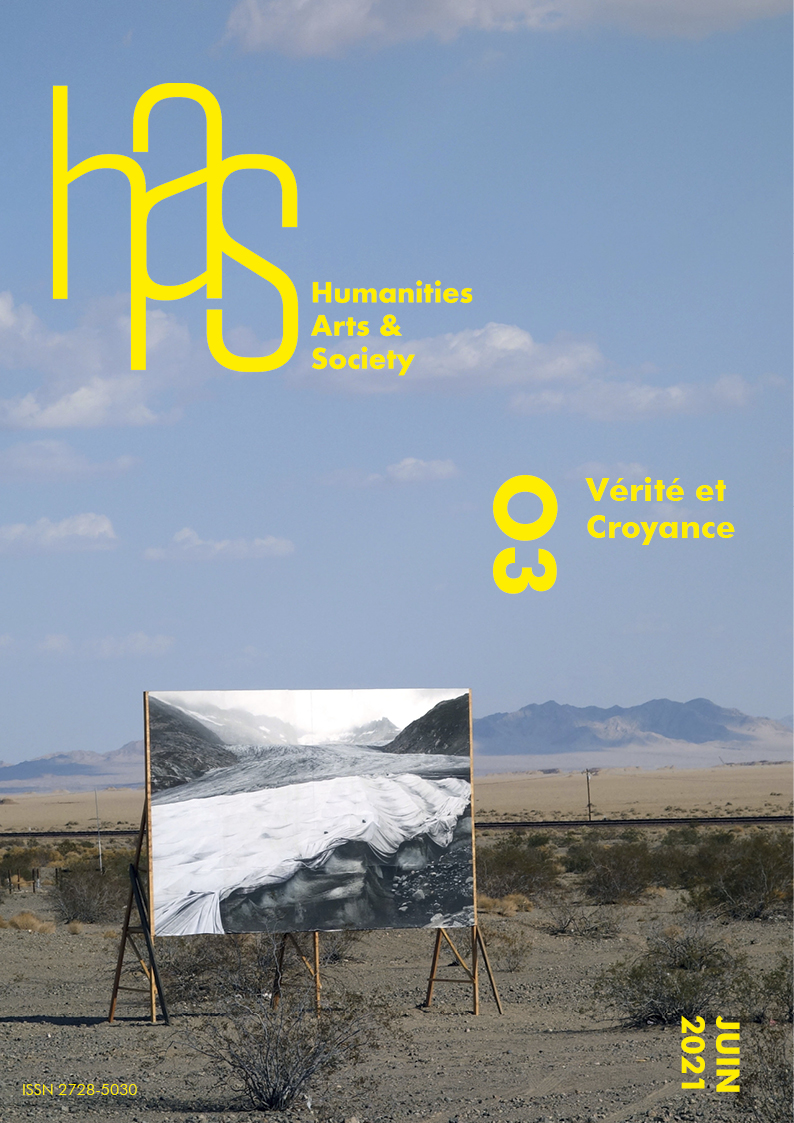En dialogue avec les oeuvres
Coller Couper et Le vertige
de Florence Pierre

Le demi-savoir triomphe plus facilement que le savoir complet : il voit les choses plus simples qu’elles ne sont, et par là en donne une idée plus compréhensible et plus convaincante.
Friedrich Nietzsche
Un virus n’a pas d’intentionnalité, à part peut-être celle de trouver des hôtes pour se multiplier puisqu’il est incapable de le faire seul. Contrairement à ce qu’on a pu lire et entendre ici et là, celui qui est responsable de la Covid-19 n’a donc nullement surgi dans le but de nous faire la morale, encore moins de nous châtier. Mais, à défaut de recevoir des leçons de sa part, nous pouvons, nous, en tirer quelques-unes pour notre propre compte, en analysant ce que nous avons appris grâce à lui, ou en regardant les effets qu’il a eus sur nous, notamment dans notre façon de parler des sciences.
En voici déjà trois qui semblent se dessiner.
D’abord, nous savons encore mieux qu’auparavant que les grandes pandémies à venir seront des « zoonoses » – c’est-à-dire des infections virales brisant la barrière inter-espèces pour se propager de l’animal à l’homme -, dont la diffusion est favorisée par les bouleversements écologiques induits par l’activité humaine. Il est donc grand temps de prendre acte du fait que nous ne pourrons pas nous abstraire du monde à notre guise. L’humanité ne constitue nullement une bulle autonome, à part. Faisant partie de la nature, elle ne saurait s’en émanciper radicalement. Curieux renversement, au demeurant : alors qu’encore tout récemment, certains techno-prophètes prédisaient notre imminente libération des soucis liés à la matérialité de notre corps grâce aux nouvelles technologies, nous voilà cruellement et brutalement ramenés à notre « socle biologique » ; et pendant de longues semaines, au lieu de courir le monde et de nous rendre encore un peu plus « comme maîtres et possesseurs de la nature », nous avons dû sagement rester chez nous, nous confiner comme faisaient nos ancêtres.
Ensuite, la pandémie de Covid-19 en cours, avec ses phases de confinement successives, a offert une parfaite illustration de l’ambivalence des technologies numériques. Nombreux sont celles et ceux qui (Covido ergo Zoom !) ont pu continuer à exercer une activité professionnelle grâce au télétravail, à bénéficier de soins grâce à la télémédecine, à se former grâce au télé-enseignement et à rester en relation, sans risque d’infection, avec leurs proches grâce aux outils de communication. Mais dans le même temps, la pandémie a rendu manifestes les effets négatifs d’une trop grande virtualisation de la société. Nous le savions, bien sûr, mais nous avons là pu le vérifier à grande échelle : le contact humain et la présence physique sont essentiels à la fois au tissu démocratique et au sentiment d’appartenance à un monde commun. Aussi impressionnantes soient-elles, les prouesses digitales n’en peuvent mais. Par exemple, la qualité du télé-enseignement est moindre que celle de l’éducation désormais (et horriblement) dite « en présentiel ». De plus, il est devenu manifeste que chacun de nous peut désormais choisir ses informations et finalement ses « vérités ». Le numérique permet en somme l’avènement d’une nouvelle condition de l’individu contemporain : dès lors qu’il est connecté, celui-ci peut façonner son propre accès au monde depuis son smartphone et, en retour, être façonné par les contenus qu’il reçoit en permanence de la part des réseaux sociaux. Il bâtit ainsi une sorte de monde sur mesure, de « chez-soi idéologique », en choisissant les communautés digitales qui lui correspondent le mieux. Se mettent ainsi en place ce que Tocqueville aurait appelé des « petites sociétés », ayant des convictions et des pensées très homogènes, chacune défendant sa cause. Dans ce monde-là, nous pouvons ne jamais être confronté à la contradiction, puisque nous ne rencontrons jamais que des biais de confirmation… Ainsi devenons-nous prompts à déclarer vraies les idées que nous aimons tout en prétendant… aimer la vérité !
Enfin, on commence à pressentir qu’au terme des débats, c’est la recherche qui aura le dernier mot. Du moins est-il permis de l’espérer. En effet, c’est seulement grâce à elle qu’on finit par savoir ce qu’il en est de telle ou telle question qui avait provoqué, par excès d’impatience, des controverses aussi intenses que stériles. Songeons aux vaccins, qui pourraient bien nous tirer d’affaire, bien plus en tout cas que tel ou tel médicament promu un temps de façon inconsidérée. On n’a guère entendu dans les médias les chercheurs qui, au prix d’un dur labeur, les ont conçus et mis au point. Signe, sans doute, que compétence et expertise s’accommodent aisément de la discrétion…
L’intelligence, c’est la chose la mieux répartie chez les hommes, parce que, quoi qu’il en soit pourvu, l’homme a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge.
Coluche
Une occasion historique d’expliquer ce qu’est la recherche
D’autres leçons sont à tirer du traitement médiatique des aspects scientifiques de la pandémie. Une opportunité quasi-historique nous était là donnée d’expliquer au grand public, en temps réel, jour après jour, la méthodologie scientifique : ses tâtonnements, ses avancées, ses multiples biais, ses succès, mais aussi en quoi consistent un essai en double aveugle, un essai randomisé, un effet placebo, un bon usage des statistiques, la différence entre une corrélation et une relation de cause à effet… Au lieu de la saisir, nous avons préféré mettre en scène une interminable foire d’empoigne entre égos ayant souvent atteint une certaine sur-dimension. D’aucuns accordaient même à leur « ressenti » un crédit si élevé qu’ils parvenaient à trancher d’un simple coup de phrase des questions vertigineusement complexes. Tout en reconnaissant, pour les plus honnêtes d’entre eux, qu’ils n’y connaissaient absolument rien (« Je ne suis pas médecin, mais je… »).
Je crains qu’une partie du public se soit ainsi laissée abuser, et considère désormais que la science est une simple affaire d’opinions qui s’affrontent sans jamais converger. Je le crains d’autant plus qu’aujourd’hui, la tendance à avoir un avis non éclairé sur tout, et à le répandre largement, semble gagner en puissance grâce aux réseaux sociaux. Dans son sillage, elle distille l’idée que la science ne relève que d’une croyance parmi d’autres. Elle serait en somme une sorte d’Église émettant des publications comme les papes des bulles, que les non-croyants ont tout loisir non seulement de contester, mais aussi de mitrailler de commentaires à l’emporte-pièce.
Entendons-nous bien : je suis parfaitement conscient que nous vivons tous dans une mare de préjugés, et que les scientifiques – qu’ils s’expriment publiquement ou non – n’échappent pas à la règle. S’ils parviennent à s’en défaire dans leur domaine de compétence, ce n’est certainement pas en purifiant leur propre intellect, ni en s’imposant une cure de désintéressement personnalisée, ni en polissant leurs phrases, mais en adoptant collectivement une méthode critique qui permet de résoudre les problèmes grâce à de multiples conjectures et tentatives de réfutation. Une vérité « scientifique » ne doit en principe pouvoir être déclarée telle qu’à la suite d’un débat contradictoire ouvert, conduisant si possible à un consensus. Bien sûr, je n’ignore pas qu’il existe des zones grises, des situations ambivalentes où la vérité, hésitante, parfois même plurielle, prête à débat. Mais ce sont alors la prudence et l’humilité qui devraient s’imposer. Je dis bien « devraient »…
Je n’ignore pas non plus que les scientifiques ne sont pas exempts des défauts coutumiers au genre humain : mauvaise foi, arrogance, bêtise, cupidité, précipitation, aveuglement, folie. Comme tout un chacun, ils peuvent se tromper, subir l’influence des idéologies ou des lobbys, parfois même tricher, de sorte que leurs déclarations quant à la vérité de tel ou tel résultat ne sauraient être prises pour argent comptant. Reste qu’en général, grâce justement au travail collectif mené à l’intérieur même du champ scientifique, de tels errements finissent par être démasqués et dénoncés.
Quand les biais cognitifs se mettent en scène à grand échelle
Il existe de multiples biais bien connus qui affectent nos jugements, dont quatre ont notamment fait florès pendant la crise.
Primo : la tendance à accorder davantage de crédit aux thèses qui nous plaisent qu’à celles qui nous déplaisent. Sans aller y voir de trop près, nous adhérons spontanément aux « vérités » qui répondent à nos vœux, rejetant les autres d’un revers de main. Gouvernés par nos émotions, notre feeling, nous prenons nos désirs pour des réalités. Et tant pis pour les faits ou les arguments qui viendraient à nous démentir.
Deuxio : ce que certains appellent plaisamment l’ipsédixitisme : « dès lors que le maître lui-même l’a dit (ipse dixit), alors on ne discute pas ». L’autorité que nous accordons à X ou Y nous incline à considérer comme vrais tous les propos qu’il tient, nous dispensant d’exercer notre esprit critique. Cette sensibilité aux arguments d’autorité procède en quelque sorte d’un « effet gourou ». Dans sa forme dégradée, ce travers nous pousse à croire qu’une chose est vraie pour l’unique raison que nous l’avons lue ou entendue.
Tertio : l’ultracrépidarianisme, autre néologisme malicieux construit à partir de la locution latine : Sutor, ne supra crepidam (« Le cordonnier doit s’arrêter au rebord de la chaussure »). Ce mot désigne la tendance, fort répandue, à parler avec assurance de sujets que l’on ne connaît pas.
Quarto : L’effet dit « Dunning-Kruger ». Parler avec aplomb de ce qu’on ne connaît pas est la manifestation d’un biais cognitif identifié depuis fort longtemps (Aristote l’évoque à sa façon) et qui fut étudié empiriquement en 1999 par deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger. Cet effet s’articule en un double paradoxe : d’une part, pour mesurer son incompétence, il faut être… compétent ! ; d’autre part, l’ignorance rend plus sûr de soi que la connaissance. Ce n’est en effet qu’en creusant une question, en s’informant, en enquêtant sur elle, qu’on la découvre plus complexe qu’on ne l’eût soupçonné. On perd alors son assurance, pour la regagner peu à peu à mesure que l’on devient compétent – mais teintée de prudence, désormais. Durant la pandémie, nous avons vu se déployer en temps réel la dynamique typique de cet effet : à mesure que nous nous sommes informés, que nous avons enquêté, creusé, nous avons fini par comprendre que l’affaire est plus complexe que nous ne l’eûmes soupçonné. Aujourd’hui, (presque) tout le monde, me semble-t-il, a saisi que cette pandémie est une affaire diablement compliquée. Du coup, l’arrogance se porte un peu moins bien qu’il y a quelques mois, sauf dans les réseaux spécialement dessinés pour lui prêter main forte.
Cela étant dit, le droit des citoyens à poser des questions, à enquêter, à émettre des avis, à interpeler les chercheurs comme les gouvernants, n’en demeure pas moins un droit absolu. Et qu’il doit leur être répondu de la façon la plus honnête possible. Mais avoir un avis n’équivaut nullement à connaître la justesse ou la fausseté d’un énoncé scientifique. Les revues scientifiques ne sont certes pas parfaites – il leur arrive de publier des articles contenant des erreurs ou présentant des conclusions biaisées -, mais ni Twitter ni Facebook n’ont vocation à concurrencer Nature, encore moins à en tenir lieu, comme ils tendent parfois à le faire ces derniers temps.
La science versus la recherche
Il est toutefois permis d’espérer qu’à la fin de cette pandémie, nos concitoyens auront pu mieux comprendre que la science n’est pas la même chose que la recherche. Les sciences représentent des corpus de connaissances, de résultats acquis, de théories qui ont été dûment mises à l’épreuve et qu’il n’y a pas lieu – jusqu’à nouvel ordre ! – de remettre en cause : la Terre est ronde plutôt que plate, l’atome existe bel et bien, E = mc2, l’univers observable est en expansion, les espèces animales évoluent, l’activité humaine modifie le climat terrestre, etc. Mais ces connaissances, par leur incomplétude même, posent des questions dont nous ne connaissons pas encore les bonnes réponses : d’où vient que l’antimatière qui était présente dans l’univers primordial a disparu au sein de l’univers actuel ? Existe-il une vie extra-terrestre ? Quelle sera précisément la température moyenne en 2100 ? Une personne malade parce qu’elle a contracté tel nouveau virus pourrait-elle être infectée une seconde fois par ce même virus ? Répondre à de telles questions dont les réponses ne sont pas connues des scientifiques, c’est le but de la recherche. Par nature, celle-ci a donc à voir avec le doute, tandis que les sciences sont constituées d’acquis difficiles à remettre en cause sans arguments extrêmement solides. Vous m’accorderez que la question de la forme de la Terre, par exemple, est grosso modo une affaire réglée. Le doute circule, lui, dans le purgatoire de l’idée de vérité, pour une durée indéterminée. Il est le véritable moteur de la recherche, en même temps que son combustible.
Mais lorsque cette distinction n’est pas faite – comme ce fut trop souvent le cas ces derniers mois -, l’image des sciences, abusivement confondues avec la recherche, se brouille et se dégrade : elles donnent l’impression d’être une bagarre permanente entre experts qui ne parviennent jamais à se mettre d’accord. Elles distillent en outre le sentiment d’être tiraillées entre excès de modestie et excès d’arrogance, car leur rapport à la vérité apparaît alors contradictoire : d’un côté, elles affirment avec assurance pouvoir l’atteindre ; de l’autre, elles se réclament du doute systématique. De l’extérieur, forcément, on a un peu de mal à suivre…
Nul résultat de recherche ne tombant directement du ciel (y compris en matière de thérapeutique !), il faut aller le chercher, laborieusement, en faisant des observations, des analyses, des mesures, des calculs, en mettant en place des protocoles, en traquant les incertitudes, les à peu près, les zones d’ombre, les erreurs qui se nichent ici ou là, en inventant aussi, parfois, d’autres techniques, ou en explorant de nouvelles idées. Il faut ensuite discuter les résultats obtenus avec d’autres chercheurs qui s’intéressent aux mêmes questions ou travaillent sur des sujets voisins. Tout cela demande du temps, beaucoup de temps, contrairement à ce que certains esprits trop zélés ont voulu nous faire croire depuis les débuts de la pandémie. Ils ont annoncé précipitamment et de façon péremptoire de prétendus résultats, notamment à propos de tel ou tel médicament, qui allaient bien au-delà de ce que les études sérieuses, qui n’avaient pas encore abouti (et pour cause !), permettaient d’affirmer. Il y a là une autre leçon à retenir : la temporalité propre de la recherche a si peu à voir avec celle de Twitter qu’on doit se méfier des proclamations individuelles et des communiqués autopromotionnels que d’aucuns jettent en pâture à une opinion particulièrement inquiète. Il faut dire qu’en période de crise, notre impatience collective crée une demande de certitudes que les chercheurs scrupuleux ne peuvent pas satisfaire puisque, précisément, ils ne savent pas encore. Par l’effet d’une logique médiatique implacable, ils se trouvent alors détrônés par d’autres intervenants qui, eux, n’hésitent guère à clamer urbi et orbi des conclusions simples et tranchées, plus plaisantes à nos oreilles que leurs discours encore hésitants, parfois maladroits.
.
Florence Pierre – Coller Couper – 2019
.
Étienne Klein est philosophe des sciences, directeur de recherches au CEA. Il dirige le Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière du CEA et est membre de l’Académie des Technologies. Il s’intéresse à la question du temps et à d’autres sujets qui sont à la croisée de la physique et de la philosophie. Il est professeur à l’Ecole CentraleSupélec. Il anime tous les samedis sur France-Culture « La conversation scientifique ». Il a récemment publié : Psychisme ascensionnel, Artaud,2020; Le Goût du vrai, Gallimard, coll. Tracts, 2020; Ce qui est sans être tout à fait, essai sur le vide, Actes Sud, 2019.
Florence Pierre, diplômée de L’Esag Penninghen en 1984, s’emploie depuis à communiquer par différentes voies créatives. Conceptrice, graphiste, directrice artistique dans la publicité, elle est aussi artiste peintre, photographe et réalisatrice. florencepierre.squarespace.com
Étienne Klein est philosophe des sciences, directeur de recherches au CEA. Il dirige le Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière du CEA et est membre de l’Académie des Technologies. Il s’intéresse à la question du temps et à d’autres sujets qui sont à la croisée de la physique et de la philosophie. Il est professeur à l’Ecole CentraleSupélec. Il anime tous les samedis sur France-Culture « La conversation scientifique ». Il a récemment publié : Psychisme ascensionnel, Artaud,2020; Le Goût du vrai, Gallimard, coll. Tracts, 2020; Ce qui est sans être tout à fait, essai sur le vide, Actes Sud, 2019.
Florence Pierre, diplômée de L’Esag Penninghen en 1984, s’emploie depuis à communiquer par différentes voies créatives. Conceptrice, graphiste, directrice artistique dans la publicité, elle est aussi artiste peintre, photographe et réalisatrice. florencepierre.squarespace.com