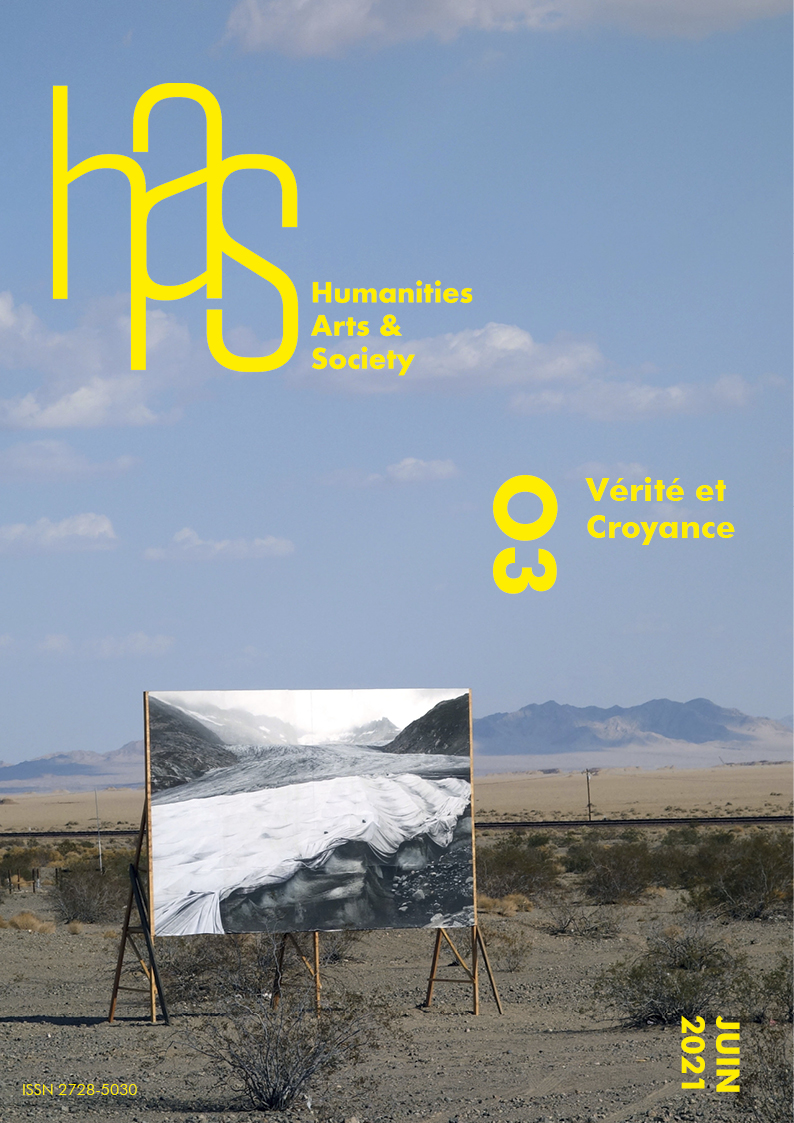31 Janvier 2021.

Images et vérité : Aux alentours de mars 2020, alors que la plupart des pays du monde se trouvaient en quelque sorte verrouillés par la pandémie de COVID19, une photographie d’un canal vénitien est devenue virale. Dans les eaux troubles, on pouvait voir des signes de vie sous la surface. La légende originale affirmait que les dauphins étaient revenus dans la lagune vénitienne en raison de la diminution du trafic humain dû au confinement. L’image a été reproduite par le National Geographic, qui a publié un article sur les fausses nouvelles sur les “succès de la faune” qui ont proliféré en ligne pendant les premiers mois de la pandémie mondiale. L’image et sa légende ont été publiées par National Geographic dans un article sur la propagation virale de faux témoignages célébrant les victoires de la faune à travers le monde. Nous pouvons sans doute attribuer la popularité de telles infox à l’immense appétit qu’avait les gens pour « trouver un côté positif » à la pandémie de COVID19 – incarnée en l’occurrence par la possibilité d’une faune sauvage triomphant des métropoles urbanisées suite au moratoire imposé sur l’activité humaine et économique. C’est une idée optimiste qui démontre bien qu’il existe un désir collectif de trouver du bon au milieu des souffrances et des dégâts qui ont suivi l’arrêt de l’économie mondiale. En même temps, la notion même d’infox engendre de l’anxiété. Cette anxiété s’est manifestée de façon exacerbée au cours des dernières périodes de confinement partout dans le monde ; une période qui a vu plusieurs milliards de personnes sommées de s’isoler, et l’accès à la connaissance du monde réduit à des écrans nous renvoyant des discours rapportés. Cet évènement renferme aussi en lui la question fondamentale du changement climatique : la peur et l’angoisse de ne pas connaître l’ampleur véritable des dommages que nous avons causés à la Terre, et l’espoir de pouvoir nous en sortir malgré nous.
L’image de la lagune vénitienne et la légende élucidant son étrange entrée dans le domaine public évoquent la complexité des fondements sur lesquelles se tient la notion de vérité dans le cadre mondial actuel de production et consommation d’images. Elles illustrent aussi ce que Nicholas Mirzoeff appelle la visualité de la société mondialisée émergente. Cette société n’est en aucun cas égalitaire (même l’accès à internet y est inégalement réparti), mais elle est toutefois connectée. Ainsi, les images sont une monnaie d’échange forte, indispensable à des opérations comme la transmission de savoirs, la formation d’identités, la gestion des populations et la fabrique du désir. Les images apparaissent non plus comme des témoins de la réalité mais comme des acteurs agissant sur la compréhension, le modelage et l’orientation mêmes notre réalité. Le moment présent de l’Histoire mondiale se caractérise par un état de crise et d’incertitude. Nous sentons bien que le système est cassé et notre seule certitude est que nous ne sommes pas encore venus à bout de l’incertitude – cependant, nous avons besoin que nos actions collectives et individuelles soient guidées par quelque chose. Cet article développe certains arguments clefs au sujet du rapport entre voir et savoir afin de soulever et répondre à deux questions : que nous disent les images photographiques sur les façons dont opèrent vérité, croyance et idéologie dans notre culture visuelle mondialisée ? L’expérience de la pandémie pourrait-elle offrir un nouvel éclairage sur nos paradigmes d’interprétation visuelle existants ?
John Berger évoquait la puissance d’allier l’image photographique et la légende (1982). Une photographie est un cliché qui représente un instant figé et un aspect donné du réel. Elle contient autant d’information qu’elle en exclut. De ce fait, la photographie porte en elle une ambiguïté qui demande à être élucidée, qui requièrt d’un manuel d’interprétation. La légende vient soutenir et valider une interprétation précise et unifie ainsi ces deux formes de communication en une vérité unique (Berger, 1982 : 92). Aujourd’hui, le caractère malléable de l’image photographique n’est plus un savoir occulte, privilège réservé aux faiseurs et critiques d’images. Bien au contraire, la duplicité de la photographie est désormais admise comme étant constitutive de la nature même de l’image. Nous sommes désormais toujours prêts à reconnaître le fait (devenu trivial) que ce que nous voyons n’est pas « vrai ». Et pourtant, nous continuons à nous fier aux images en tant que source de connaissance sur le monde. La « preuve par l’image » ainsi compromise, les « faits réels » deviennent plus essentiels que jamais. Mirzoeff qualifie la société mondiale émergente (et inégalitaire) de société visuelle. Dans notre réalité contemporaine où les images circulent plus frénétiquement que jamais, que peut-on savoir à travers l’acte de voir ? En dépit des régimes idéologiques qui voudraient nous faire croire le contraire, la réponse simple est que voir n’est pas savoir. Selon Mirzoeff, « nous ne voyons pas simplement ce qu’il y a à voir ». En réalité, quand nous voyons, nous « constituons un regard sur le monde qui sera conforme avec ce que nous connaissons et avons déjà expérimenté » (2015 : 11). Il existe des institutions et des intérêts puissants qui se disputent l’influence sur nos visions du monde et nos façons de voir. Afin de mieux identifier ces intérêts Mirzoeff propose une réflexion sur nos façons d’agir dans le monde d’aujourd’hui à travers le prisme de la notion de culture visuelle – notamment en développant comment la photographie, devenue une technologie du quotidien, a bouleversé le monde dans lequel nous vivons et notre manière même de le penser. Une culture visuelle est une manifestation de la théorie de la société en réseaux de Manuel Castells. C’est « la relation entre ce qui est visible et les noms que nous donnons à ce qui est vu » (Mirzoeff, 2015 :11).

Images et souffrance : Considérez cette image d’un dinghy bondé de personnes. Certaines personnes ont des gilets de sauvetage, d’autres non. Il n’y a pas de légende, mais un conditionnement visuel de la machinerie médiatique mondiale oriente le spectateur vers la conclusion qu’il s’agit de migrants et de réfugiés traversant probablement la Méditerranée. Ce type de photographies sont reproduites si fréquemment qu’elles accompagnent visuellement des articles tels que celui d’Aljazeera intitulé Cinq pays de l’UE conviennent d’un nouvel accord pour les migrants secourus en mer. Le texte ne porte pas sur le groupe de personnes photographiées, mais sur les politiques des pays voisins à l’égard des personnes “comme celles-ci”. Ainsi, les personnes photographiées deviennent des illustrations d’une réalité qui dépasse leurs circonstances particulières. En tant que telle, cette image fait partie de la documentation d’un phénomène qui ne peut pas être décrit comme une crise ou un événement qui passera, mais comme un discours puissant utilisant les métaphores de l’inondation et du déferlement – une condition permanente du capitalisme mondial dans un monde post-colonial. Une photographie peut devenir un opiacé à l’effet anesthésiant ; les représentations de crises et de souffrances peuvent agir comme de simples signaux superficiels de notre réalité. Et pourtant, nous savons que l’image et la photographie peuvent agir en tant que véritables appels aux armes contre différentes formes d’oppression (l’exemple le plus probant des derniers temps étant les images de violences policières aux États-Unis). Nous devons prendre en considération cette double fonction et réfléchir à quel degré nous maitrisons, ou pas, la manière dont nous percevons les choses.
Au cours des dernières décennies, la machinerie médiatique mondialisée a familiarisé le monde entier avec des images de scènes dystopiques issues de différents endroits de la planète. Des ouvriers d’usine soumis à des conditions de travail inhumaines en Asie du Sud-Est jusqu’aux éboueurs des métropoles grouillantes en Afrique : la spécificité a peu d’importance dans la communication médiatique où l’on fait permuter Dhaka et Delhi, Nairobi et Lagos. Des millions de personnes font l’expérience directe de ces réalités et n’ont pas besoin de se confronter à des images de souffrance pour savoir que celle-ci existe. D’autres millions de gens n’en prennent justement connaissance qu’au travers des images. Les effets de cette « connaissance » est cependant discutable. Susan Sontag exprime un cynisme certain face au lien présumé entre le fait de savoir et le fait d’agir. Nous savons beaucoup de choses au sujet de la souffrance dans le monde et si nous ne cessons de recréer des systèmes qui alimentent les mêmes conditions injustes c’est en partie précisément parce que les photographies ont cette capacité de nous désensibiliser à la douleur des autres et d’agir en tant qu’anesthésiant politique. Face à l’image photographique, Sontag se méfie de l’émotion de sympathie qu’elle juge dangereuse. Nous aimons croire qu’éprouver de la tristesse face aux souffrances que nous témoignons suffit à nous acquitter de notre dette morale, émotionnelle et psychologique (2003:92). Selon Sontag, si nous parvenions à résister à cette fausse mais tentante absolution et à laisser la sympathie de côté, nous pourrions commencer à nous confronter à l’épineuse réflexion de « comment nos privilèges et la souffrance des autres coexistent sur un même territoire et comment les deux peuvent même être – dans des formes que l’on préféreraient ignorer – étroitement liés ; tout comme la richesse des uns peut impliquer la destitution des autres » (2003 :92). Considérer la souffrance d’autrui avec sympathie plutôt qu’avec empathie, indignation ou honte, nous permet de maintenir une distance entre nos vies, nos mondes et « les leurs ».
Muni des arguments du célèbre essai de Sontag au sujet des effets sociaux de la photographie, je dirai que les images de souffrance humaine sont désormais devenues partie intégrante du tissu même de notre compréhension collective du capitalisme mondial tardif. Tout comme les bancs de méduses servent de métaphore pour un monde homogénéisé, propagé par le système actuel. La lisibilité de ce type d’images suggère que désormais cette acceptation nihiliste de la vacuité morale caractérise l’attitude autocentrée du dit « capitalisme tardif ». Francis Fukuyama a fameusement dit de la chute du mur de Berlin que c’était « la fin de l’Histoire » et le triomphe du capitalisme et du libre marché sur le communisme. Sa formule exprimait la nature téléologique de l’idéologie capitaliste : le système est voué à l’échec, il nous mènera au désastre mais nous n’avons pas le choix car il n’existe aucune alternative. Au sein de cette logique, l’inadmissible devient acceptable, tant que nous parvenons d’une façon ou d’une autre à externaliser l’inégalité. Les images peuvent être utiles à cette entreprise, ou disruptives.
Images, idéologie et inégalité : Une idéologie est plus efficace lorsqu’elle parvient à se faire passer pour l’opinion indépendante des individus. A l’âge du capitalisme de surveillance, et tel que l’on démontré de nombreux théoriciens des médias, la consommation et production d’images est désormais un geste qui relève à la fois du domaine de l’intime et du public. C’est le terrain idéal pour que des idéologies dominantes comme le nationalisme puissent s’enraciner et manifester le politique dans le privé. Et pourtant, l’espace de consommation et de production d’images est animé par des tensions et des formes de résistance certaines. Au cours du premier trimestre de 2020, l’OMS annonçait que plus de la moitié de la population mondiale était sommer de rester confinée. Cet appel à l’isolement sans précédent a vu des milliards de personnes à travers le monde se tourner vers les images comme source principale de connaissances sur la « réalité » en dehors de leur sphère immédiate. Les vidéos virales d’italiens urbains s’adressant via leur webcam à toute une communauté mondiale virtuelle, me sont apparues comme un avant-goût de notre futur. Jamais je n’aurais cru pouvoir me sentir à ce point proche d’un professeur à Milan, jamais le simple fait d’avoir un domicile dans lequel me confiner m’avait paru être un tel privilège dans ma propre ville. L’évènement a exposé l’interconnexion et l’inégalité du monde plus clairement que jamais. Le sujet d’un monde interconnecté dans lequel privilèges et souffrances sont deux faces d’un même système économique est un sujet qui est au centre des débats tenus par les activistes, penseurs, et membres des communautés marginalisées depuis des décennies – que ce soit par rapport au racisme systémique, aux graves lacunes dans les concepts des droits de l’Homme ou de la lutte pour le climat. Nous peinons encore à correctement sonder la réalité et l’ampleur de l’interconnexion, et ce en partie parce que nos paradigmes visuels dominants sont informés par des puissances idéologiques qui renforcent des notions politiquement arrangeantes telles que état nation, citoyenneté, étranger, pauvre, riche, développé, sous-développé, arriéré, futuriste.

En 2016, le sud-africain Johnny Miller commençait un travail de documentation des zones urbaines à l’aide d’un drone. Les images qui en découlent montrent la proximité dans laquelle cohabitent privilège et souffrance. L’image ci-dessus, choisie pour faire la couverture du Times Magazine 2019, montre la banlieue riche de Primrose à gauche et le bidonville de Makause à droite. Nous pourrions convoquer, ici encore, l’idée de Mirzoeff selon laquelle nos visions du monde nous permettent de voir ou de ne pas voir certaines réalités. Si la couverture du Time Magazine 2019 ramène cette réalité à un contexte national particulier, c’est l’omniprésence mondiale de cette visualisation d’inégalité que continuent de démontrer le photographe et ses collaborateurs : « C’est l’ampleur et l’implacable récurrence [de cette vision] dans toutes les régions du monde qui démontrent la nature systémique de l’inégalité. Il ne s’agit pas d’un phénomène organique mais bien d’un projet organisé et planifié de destitution » (Miller, 2018). Nous pouvons tenter de fermer les yeux dessus – d’ailleurs, les cadres idéologiques et spatiaux qui guident nos comportements au quotidien s’évertuent à le dissimuler – mais : « nous vivons dans des communautés et participons à des économies qui renforcent l’inégalité. Nous nous y habituons au moyen de routines et prenons pour acquis l’environnement urbain construit » (Miller, 2018). Voir des réalités que la technologie est capable de rendre visible peut constituer un acte de résistance face aux « structures de pouvoir traditionnelles qui tentent de dissimuler ces inégalités de tous les angles, sauf du haut ». L’image d’Afrique du Sud employée par Time Magazine a fait la une de nombreux autres journaux cette même année. Le fort intérêt médiatique attribué à cette visualisation est marqueur d’espoir. Cet espoir réside dans notre capacité d’ être encore angoissé par ce que nous voyons. Pour citer Johnny Miller : « Si les images provoquent des sentiments de peur, de désespoir ou un sentiment dérangeant de complicité – c’est bien. C’est le but. » (Miller, 2018). Le potentiel d’identification contenu dans cette image d’Afrique du Sud – tout comme celles prises au Mexique, aux États-Unis, au Kenya ou en Inde où le photographe et ses collaborateurs ont poursuivi leur travail de documentation – permet d’envisager les visualisations d’inégalité et de souffrance sous un nouveau paradigme qui ne reproduit plus aussi facilement le paradigme du soi/autrui, citoyen/étranger.
Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, le terme « apocalyptique » et même parfois celui de « post-apocalyptique » ont été invoqués pour décrire la situation dans des villes comme Venise et New York – des lieux qui n’ont connu de catastrophes ou bouleversements totaux au XXIᵉ siècle que dans les studios d’effets spéciaux de Hollywood. Il nous reste encore à comprendre comment ce recalibrage visuel des puissants comme étant à mille lieux des souffrants, perce notre conscience collective. Des signaux d’alarme nous l’indiquent depuis un moment déjà : notre conception linéaire du progrès – soutenue par des notions comme celles de « pays développés » ou « sous-développés » et que nous prenons pour de simples marqueurs géographiques et culturels – est à revoir d’urgence. Peut-être qu’alors notre littératie visuelle nous rattrapera et que nous pourrons commencer à voir ce qui existe différemment. Slavoj Zizek dit de « l’évènement » qu’il est un moment fondateur de l’existence humaine, pouvant prendre des formes ainsi bien personnelles que collectives. C’est un tournant après quoi plus rien n’est pareil. Selon Zizek, l’évènement en tant qu’effet qui dépasse ses propres causes (nous ne pouvons simplement pas l’expliquer ou bien nous ne pouvons pas l’expliquer simplement) – pose un problème philosophique : « l’évènement constitue-t-il un changement dans la manière dont nous percevons la réalité, ou bien est-ce une transformation de la réalité elle-même ? » (2014:5). Quoi qu’il en soit, la conséquence de cette rupture avec la normalité est qu’elle nous offre un prisme singulier à travers lequel revoir les cadres idéologiques dominants. Si nous considérons ici le rapport entre voir et savoir, deux points clefs émergent : si nous voyons la pandémie comme un « évènement », cela pourrait nous permettre de voir des fissures qui se manifestaient déjà au sein de nos paradigmes de visualisation acceptés. Cela pourrait nous pousser à pratiquer des nouvelles façons de voir, autres que notre vision intermittente actuelle, qui pourraient servir à créer un monde plus juste et durable.
Bibliographie:
- Azoulay, A. 2019. Potential History. Verso: New York
- Berger, J & Mohr, J. 1982. Another way of telling. Pantheon Books: New York
- Miller, J. www.unequalscenes.com
- Mirzoeff, N. 2013. How to See the World. Penguin Random House: London
- Sontag, Susan. 2003. Regarding the pain of Others. Penguin Books: London
- Zizek, S. 2014. Event. Penguin Random House: Londons
Images:
- Venetian Lagoon (Photographie Andrea Pattaro). Daly, N. 2020. Fake animal news abounds on social media as coronavirus upends life. National Geographic Online. Mars 2020. Lien: https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/03/coronavirus-pandemic-fake-animal-viral-social-media-posts/
- Migrants on a boat (Photographie de Guglielmo Mangiapani). Tirée de: Aljazeera News Agencies. 2019 (Septembre). Five EU countries agree new deal for migrants rescued at sea. Aljazeera Online. Lien: https://www.aljazeera.com/news/2019/09/eu-countries-agree-deal-migrants-rescued-sea-190923162305245.html
- Johannesburg settlements and suburbs (Photographie de Johnny Miller). Tirée de: https://unequalscenes.com/about et Pomerantz, K. 2019. The Story Behind TIME’s Cover on Inequality in South Africa. Time Magazine Online. 2 MAI 2019 7:30 AM EDT. Lien: https://time.com/5581483/time-cover-south-africa/ https://time.com/5581483/time-cover-south-africa/
Sophia Sanan is a writer and researcher from South Africa. She is currently writing her doctoral dissertation which traces the political economy of historical African Art in Cape Town. She holds a master’s degree in Sociology and a professional background in African cultural policy development, education and art related research. She has taught university students for the last 10 years, in South Africa, Uganda, the USA, Brazil and India. Her published research work has focused on arts education, social justice and institutional racism and the social, cultural and material dimensions of African migration in South Africa and India.
Sophia Sanan is a writer and researcher from South Africa. She is currently writing her doctoral dissertation which traces the political economy of historical African Art in Cape Town. She holds a master’s degree in Sociology and a professional background in African cultural policy development, education and art related research. She has taught university students for the last 10 years, in South Africa, Uganda, the USA, Brazil and India. Her published research work has focused on arts education, social justice and institutional racism and the social, cultural and material dimensions of African migration in South Africa and India.