
Nous abordons dans cette proposition les notions d’anxiété et d’espoir par le biais d’une forme littéraire, artistique et philosophique majeure, l’utopie. Nous verrons comment, avec son contrepoint la dystopie, elles se sont imposées comme un outil essentiel à l’analyse et à la critique d’une époque en questionnant tout autant ses aspirations que ses aspects les plus anxiogènes. Ainsi littérature, cinéma et architecture ont fait appel au binôme utopie/dystopie pour formuler un questionnement productif sur notre société. Nous montrerons que le numérique, à travers la production de simulations, est devenu un territoire pertinent dans la poursuite de cette réflexion critique.
Histoire d’un couple antagoniste
À l’origine, l’utopie est une forme littéraire. Le néologisme, formé en 1516 par Thomas More pour son livre Utopia, définit une forme de société idéale « qui ne se trouve nulle part ». Inspiré par La république de Platon, le livre doit avant tout se comprendre comme une critique humaniste, une description en creux des injustices qui rongent les sociétés européennes du XVIe siècle, et plus particulièrement l’Angleterre. Dans la seconde édition, Thomas More ajoute au titre initial le terme homonyme en anglais « Eutopia », précisant l’idée d’un « lieu du bon ». Ce double sens révèle la nature de l’utopie : procédé davantage littéraire que politique, elle est une création imaginaire, un idéal qui ne saurait prendre place dans la société humaine. Paradoxalement, parce qu’elle prétend répondre par une forme sociale univoque à l’ensemble des aspirations et contradictions humaines, elle porte aussi les germes d’une pensée de nature idéologique.
La notion de dystopie, étymologiquement un « lieu négatif », apparaît plus tardivement au XIXe siècle, toujours en Angleterre. La dystopie est la réalisation de l’utopie au sein d’une société et devient le prétexte à l’observation du dysfonctionnement de cette utopie, sa mise à l’épreuve des faits. Elle en révèle les failles, les sous-entendus, les potentiels risques sociaux et politiques. Dans la littérature, elle prend le point de vue de l’individu, montrant l’absurdité du traitement auquel le soumet une utopie ayant évolué de réflexion philosophique à système hégémonique mis en application. Les exemples littéraires de dystopies abondent, et constituent pour certains des œuvres majeures susceptibles d’incarner leur époque : Le meilleur des mondes (Aldous Huxley, 1932), 1984 (Georges Orwell, 1948), La planète des singes (Pierre Boulle, 1963), La servante écarlate (Margaret Atwood, 1985), Soumission (Michel Houellebecq, 2015). Au final, cette forme littéraire dérivée s’avère plus prolifique et féconde que sa source l’utopie.
Dans les années 1960, la jeunesse et les milieux intellectuels sont animés par une telle soif de révolution et d’idéaux que toute forme de critique constructive est dévalorisée par l’étiquette « réactionnaire ». Ce que comprennent malgré tout certains intellectuels, comme Guy Debord en France ou Pierre Paolo Pasolini en Italie, est que cette révolution nouvelle, même si elle se situe dans la lignée de combats légitimes et progressistes, correspond aussi à l’émergence d’une société bourgeoise structurée par la consommation marchande doublée d’une forme nouvelle de société du spectacle. La liberté totale, absolue, fulgurante, mène-t-elle prosaïquement à une consommation addictive, au triomphe des marques internationales et aux gloires éphémères des réseaux sociaux ? L’utopie porte-t-elle tragiquement sa propre dystopie ? Il ne s’agit pas ici de remettre en question la liberté, acquis essentiel et universel, mais au contraire d’essayer de comprendre à quel moment une idéologie se substitue à un idéal, quel curseur marque le glissement entre une utopie légitime et sa réalisation désincarnée. La question est complexe, car la nature de l’idéologie est d’être diffuse pour les esprits qui la partagent, elle constitue une manière invisible d’interpréter le monde. Il est donc essentiel de construire des mécanismes susceptibles de la rendre visible, l’obligeant à dévoiler ses conséquences les plus cachées. Parfois accusée d’être réactionnaire, la dystopie constitue pourtant un outil pertinent pour décortiquer le sens profond d’une idéologie. Elle interroge le futur, révélateur davantage que programme politique, laissant l’individu éclairé libre de ses choix et de ses idéaux.
Le cinéma, média privilégié de la dystopie
Le XXe siècle voit la dystopie devenir une source d’inspiration pour les arts. Le film succède au roman du XIXe siècle comme forme classique de narration, il devient le témoin privilégié de son époque. D’abord tiré par l’adaptation d’œuvres littéraires, le cinématographe engendre de plus en plus de productions basées sur des scénarios originaux interrogeant des thèmes sociétaux de manière directe : la société de classes dans Metropolis (Fritz Lang, 1927), la boucle itérative du temps et l’éternel retour dans La jetée (Chris Marker, 1962), la déshumanisation de la société par le biais d’un super ordinateur dans Alphaville (Jean-Luc Godard, 1965), la société des immortels Éternels contre le peuple des Brutes dans Zardoz (John Boorman, 1974), l’administration tentaculaire et dysfonctionnelle de Brazil (Terry Gilliam, 1985), ou encore la dépendance collective à une forme addictive et organique du virtuel dans Existenz (David Cronenberg, 1999).
Dans ces œuvres est questionnée, au-delà du récit politique, philosophique et humaniste, l’importance des lieux servant de cadre aux dystopies. Comment incarner le lieu et la forme d’une utopie déréglée ? Doit-elle prendre place dans un espace purement imaginaire, ou est-il au contraire pertinent de l’inscrire dans des fragments sélectionnés de notre présent, pour mieux montrer sa proximité ? Certains réalisateurs choisissent de privilégier le travail en studio et les effets spéciaux, comme dans le Metropolis de Fritz Lang, dont la ville verticale étonne encore aujourd’hui par sa puissance d’évocation. D’autres réalisateurs s’emploient au contraire à tordre le cou au réel, à construire une utopie détournant des éléments architecturaux et urbains contemporains dans l’optique d’en extraire la potentialité futuriste. On citera ici plus particulièrement La jetée, Alphaville, le provocant Orange mécanique de Stanley Kubrick, ou plus près de nous la vision baroque du Brazil de Terry Gilliam. Avec cet usage du réel s’inscrit plus directement une critique de la modernité, de ses lieux déshumanisés et de ses modes d’habiter dans des fables anticipatives qui nous parlent très directement de notre présent.

Des outils critiques de la pensée urbaine
Les domaines de l’architecture et de l’urbanisme entretiennent depuis longtemps un lien étroit avec les notions d’utopie et de dystopie. À la Renaissance, parallèlement à l’idéal universaliste et humaniste d’un monde meilleur, se construit l’idée d’une Cité idéale susceptible de l’incarner. Elle vise à installer physiquement l’utopie au sein d’une organisation spatiale et sociale et reprend le modèle dominant en Italie à cette période, la cité état. Pendant plusieurs siècles, le thème sera décliné en fonction des aspirations de l’époque, depuis le Familistère de Jean-Baptiste André Godin jusqu’aux architectures prérévolutionnaires d’Étienne-Louis Boullée et de Claude Nicolas Ledoux.
Au XIXe siècle, le modèle des cités jardins propose une utopie hygiéniste associée au lieu de production, l’usine, afin de sortir les ouvriers des miasmes qui amoindrissent leur productivité et nuisent au bon développement du capitalisme. Cet aspect idéologique du bonheur imposé pour tous culminera au début du XXe siècle avec la ville idéale de Le Corbusier dont Le plan Voisin constitue un jalon essentiel. L’urbanisme tout autant que le bonheur y sont autoritaires, imposés à un individu incarné par une forme d’homme idéal, sportif et moderne. Mais ce plan d’aménagement ne précède que de quelques années l’expansion du fascisme dans toute l’Europe, avec lequel il entretient des liens idéologiques
ambigus.
L’utopie architecturale reste encore vivace quelques années après la seconde guerre mondiale. Dans les années 60, les projets pop et avant-gardistes du collectif anglais Archigram et le mouvement des mégastructures forment une sorte de spectaculaire chant du cygne, mais l’époque soulève pourtant de plus en plus de questions critiques sur l’existence d’un modèle idéal : la société démocratique, qui s’est construite dans un contexte social et historique complexe, reflet de la nature humaine, peut-elle se résoudre à un principe d’aménagement urbain de nature utopique, aussi brillant et esthétique soit-il ? Si les architectes, persuadés du pouvoir social de leurs constructions, sont devenus de formidables producteurs d’images au service d’une idéologie de l’habiter, il se forme néanmoins parmi eux des collectifs développant une réflexion plus critique sur la pertinence d’une modernité à tout prix. À ce titre, la naissance de l’Architecture radicale, qui privilégie la dystopie à l’utopie pour explorer les questions sociales et esthétiques propres à l’habitat, marque un tournant de la pensée urbaine.
Projet précurseur du genre, « No stop City » (Archizoom Associati, 1969) est une dystopie imaginée par l’architecte et designer Andrea Branzi. Cette ville sans fin organise « l’idée de la disparition de l’architecture à l’intérieur de la métropole ». Concrètement, la ville, devenue territoire infini, se développe selon une conception proche du supermarché ou du parking. L’architecture souterraine, réduite au rôle de simple trame, propose des espaces neutres, climatisés et isolés de l’extérieur, dans lesquels l’individu organise son habitat comme un nomade au sein de la société de consommation. Andrea Branzi revendique la dimension provocatrice et critique de sa dystopie « Aux utopies qualitatives, nous répondons par la seule utopie possible : celle de la Quantité ». Dans une époque où se développent les discours sur les bienfaits de la consommation, il nous oblige à une distanciation critique, nous fascinant par un discours dont nous comprenons en même temps les conséquences les plus négatives.
Développant encore cette dimension critique, le projet « Exodus » (Rem Koolhaas, Marion Elia et Zoé Zenghelis, 1972) se présente comme une fiction, une sorte de fable composée de 18 images accompagnées d’un texte. Au cœur de Londres, une bande urbaine monumentale abrite un peuple de réfugiés venus se livrer totalement au règne d’une architecture dominatrice. Inspirée par la situation propre au Berlin des années 70 et à son mur, elle décrit un monde divisé en deux, ou les habitants du mauvais côté s’emploient désespérément à venir habiter le bon. S’ils y parviennent, ils se livrent alors à une série d’expériences au sein de séquences architecturales extrêmes. Comme avec Andrea Branzi, le ton joue d’un second degré ironique inhabituel chez des concepteurs plutôt habitués à valoriser les bienfaits inhérents de leurs propositions urbaines.
L’architecture radicale, par sa puissance d’évocation, constitue aujourd’hui une référence dont l’influence intellectuelle dépasse le cadre de l’aménagement urbain. Il s’agit d’une réflexion globale et profonde sur le modèle de société que nous souhaitons mettre en œuvre. Les protagonistes de ce mouvement ont d’ailleurs emprunté par la suite des chemins divergents. Tandis que certains italiens emprunt d’histoire marquèrent leur production d’un retour à une ville classique, le Hollandais Rem Koolhaas développera au contraire une architecture inscrite au sein du chaos urbain des grandes mégalopoles.
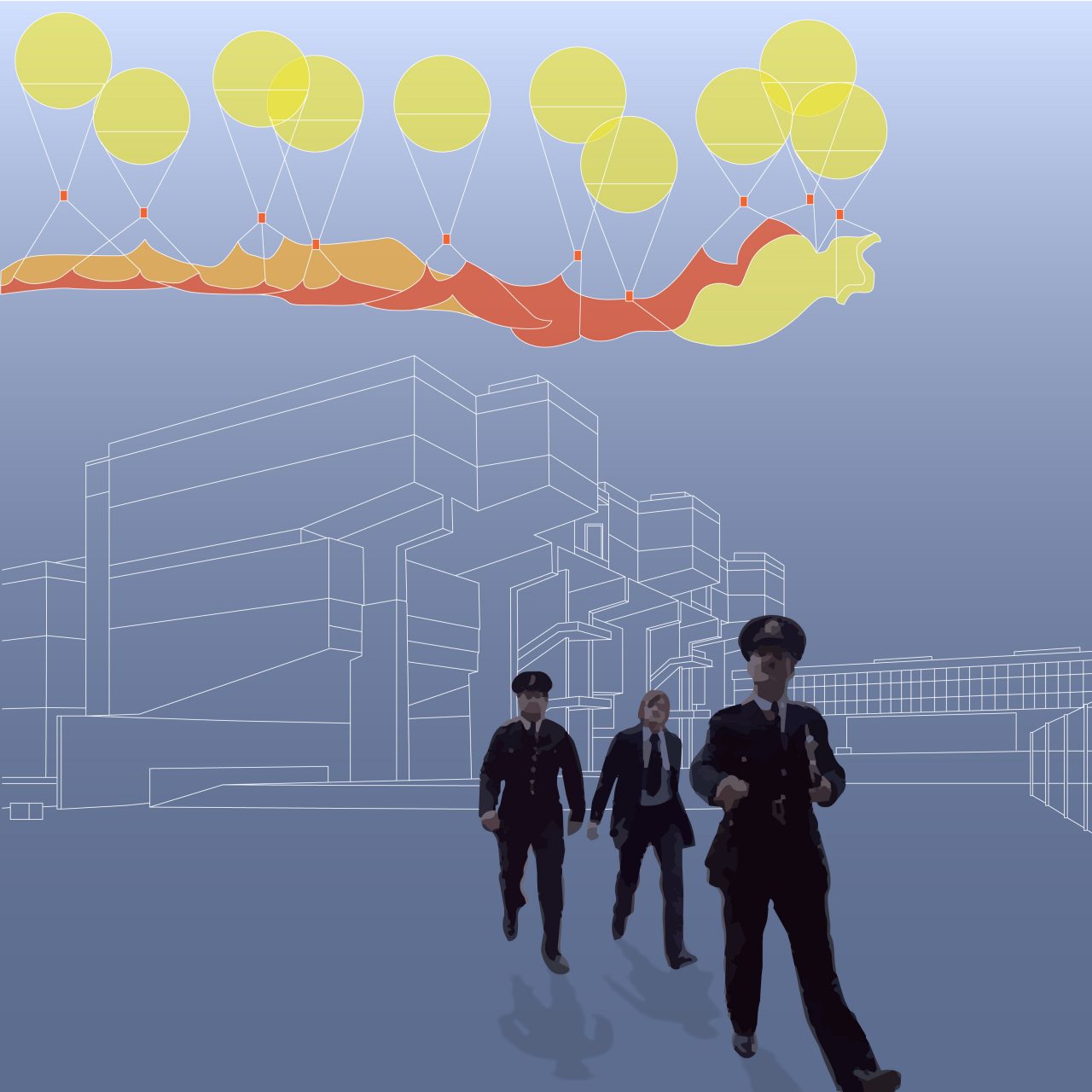
La simulation numérique, moyen d’exploration des possibles
Un domaine de création contemporain, le numérique, est sans doute le plus à même de prolonger le dialogue entre utopie et dystopie. Sous-tendu par une programmation qui en modifie le mode d’expression, le numérique se caractérise par le basculement de la représentation traditionnelle, qu’elle soit picturale ou photographique, vers une forme de représentation temps réel, la simulation. L’image perd en vérité ce qu’elle gagne en interactivité, elle cesse d’être une représentation du réel pour devenir la forme d’exploration ludique ou scientifique d’un modèle numérique.
L’utopie a ainsi alimenté le secteur du jeu vidéo depuis sa création. Publié en 1981 par Mattel, Utopia se présente comme l’ancêtre de tous les jeux de simulation qui lui succèderont. Deux joueurs en compétition y développent chacun leur île, accroissant la population, développant son urbanisme. Si le graphisme reste encore simplifié, le jeu utilise déjà une forme sommaire d’intelligence artificielle. Par la suite, de nombreux jeux s’inspireront de ce concept de développement, selon des règles scénaristiques mettant en œuvre un ensemble de variables et de fonctions mathématiques pour définir ce que serait une société idéale, comme dans le célèbre Civilization (1991), un jeu construisant son récit depuis l’âge de pierre jusqu’à la conquête spatiale. Dans le sous-genre spécifique du God game, Black and White de Peter Molyneux (2001) propose au joueur de s’incarner en un dieu surpuissant, capable d’offrir bonheur et prospérité à ses sujets ou au contraire de détruire arbitrairement leurs réalisations. Dans ce registre vidéoludique, la forme dystopique est trop souvent réservée à des jeux d’action à la première personne. Elle sert de cadre apocalyptique à des missions individuelles basées sur la violence, ce qui en restreint la portée philosophique ou humaniste. Des œuvres comme Half-life 2 (2004) offrent d’éliminer un grand nombre d’ennemis en parcourant différents niveaux, le contexte sociétal étant relégué à une toile de fond décorative. Si le joueur est soumis à une oppression politique ou sociale, ce n’est qu’un prétexte pour exalter son individualisme et justifier son droit à éliminer et détruire ce qui fait obstacle à une vision manichéenne du bien.
Malgré les limites posées par le jeu vidéo comme support d’expression de la dystopie, se ressent pourtant la puissance d’évocation et la richesse des possibilités offertes par ce média. Comment une simulation numérique scénarisée peut-elle devenir le cadre d’une réflexion pertinente sur nos idéaux sociétaux et leurs conséquences ? Si l’on ouvre notre réflexion à de plus larges domaines, il apparaît évident que la simulation est devenue un outil privilégié de la recherche scientifique. La création de modèles numériques permet de déplacer le champ de l’expérimentation depuis des expériences physiques vers des simulations virtuelles. Grâce à l’emploi des mégadonnées, on a ainsi fait basculer dans le domaine de la simulation la météorologie, les réactions nucléaires, la conception aérodynamique, les tests financiers ou encore la résistance structurelle des ouvrages d’arts. Aujourd’hui, l’informatique quantique simule même le comportement des particules élémentaires dans le cadre de réactions chimiques, permettant de relier le comportement de la matière entre des disciplines scientifiques autrefois dotées de théories distinctes.
Il ne serait cependant pas raisonnable de reprendre l’ensemble des paramètres caractérisant une dystopie comme autant de variables ajustables dans le cadre d’une simulation. Les domaines abordés sont trop vastes pour que le projet s’avère réaliste : économie, architecture, urbanisme, écologie, sociologie, technologie. Pour chacun d’entre eux, le champ des possibles est immense, tandis que les simulations numériques actuelles se concentrent au contraire sur la résolution de problèmes précis nécessitant une forte quantité de calculs. Ce qui nous est en revanche accessible est la possibilité de faire interagir le public avec des données structurantes sélectionnées au préalable, d’établir une forme de scénario narratif en laissant la possibilité au visiteur de le pousser vers ses extrémités, de manière à rendre visible ce qui dans l’esprit reste de l’ordre des idéaux mais ne s’est pas matérialisé sous une forme concrète. Il s’agit non seulement de donner à voir, mais surtout de donner à réfléchir.
Thématiques pour une dystopie contemporaine
Notre proposition consiste à élaborer une simulation sociale et environnementale mettant en œuvre les points structurants des idéologies émergentes. Il s’agit donc en premier lieu de les identifier. Si notre époque tend particulièrement à masquer la dimension tragique de l’existence, elle est pourtant le théâtre de nombreuses catastrophes : l’Holocène, le réchauffement climatique et ses conséquences environnementales, les migrations humaines qui en résultent, la montée des populismes forment autant de drames qui obscurcissent notre capacité à nous projeter dans l’avenir et semblent converger vers une rupture civilisationnelle. Mais l’esprit humain a besoin d’espoir, une société ne se construit pas sans valeurs ni idéaux. Aujourd’hui, l’écologie, l’agriculture biologique, la bio-inspiration, le développement durable, la décroissance et le localisme sont autant de sujets capables de cristalliser ces idéaux.
Une dystopie ne pourrait néanmoins se contenter d’enfoncer des portes ouvertes, sous peine de voir sa portée critique amoindrie. Sa nature est prospective, elle ne cherche ni à inquiéter ni à rassurer. Examinons pour finir quelques marqueurs sociétaux contemporains susceptibles d’être conjugués au sein d’une fiction dystopique.
Cosmogonie scientifique
Là où la religion se caractérise par une attitude dogmatique et une absence de perspective d’évolution de ce dogme, la science procède au contraire par l’établissement de théories susceptibles d’être renversées par d’autres théories plus pertinentes, le seul juge restant l’expérience répétée et validée par des pairs. Depuis le début du XXe siècle, et l’avènement de la théorie de la relativité, la science atteint un niveau métaphysique la positionnant aussi comme un questionnement sur notre univers. La physique quantique, lorsqu’elle nous extrait d’un monde newtonien purement déterministe ne laissant aucune place à l’action d’un dieu, ramène avec un hasard authentique et irréductible un ensemble de questions sur la nature même du réel. Dès lors, de nombreux éléments semblent converger vers l’éclosion d’une nouvelle cosmogonie s’appuyant sur les hypothèses scientifiques issues de notre connaissance nouvelle des lois de l’univers : formes du temps et de l’espace, nature du big bang et existence d’univers parallèles à l’échelle macroscopique, mais aussi structures neuronales, composants d’un cerveau considéré comme la structure la plus complexe de l’univers connu, décodage et interprétation du génome des êtres vivants à l’échelle microscopique ou encore théorie de l’évolution à l’échelle humaine. Une telle recherche spirituelle, par nature évolutive, peut-elle échapper à la tentation sectaire des pseudosciences, comme le montre un mysticisme quantique basé sur des interprétations spéculatives et erronées de la théorie scientifique ?
Transhumanisme
La capacité à contrôler les naissances, héritière de l’eugénisme, et le désir de modifier le vivant ont déjà été abordés dans de nombreuses fictions dystopiques. Notre époque y ajoute, avec le transhumanisme, une confusion sur la nature même du vivant. L’idée d’une « singularité », un point temporel à partir duquel une intelligence artificielle supplantera les capacités humaines, que l’on annonce très proche, et l’espoir de transférer complètement un humain dans le réseau informatique mondial pour le rendre éternel et omniscient forment deux marqueurs dont nous ne savons pas distinctement s’ils constituent un futur possible ou le fruit d’une idéologie malsaine et déréglée. Si l’homme augmenté est une hypothèse prenant corps avec chaque progrès de la science, la nature même de notre conscience ne saurait se résumer à un simple cerveau convertible en données, celui-ci restant inextricablement imbriqué avec l’ensemble des terminaisons nerveuses et physiques de notre corps. L’objectif du transhumanisme, une forme de vie éternelle, ne ramène t-il pas aux mythologies les plus anciennes, comme celle incarnée par Icare, annonçant par son refus d’une nature humaine transitoire une chute inévitable ?
Animalisme
Dérivé de l’ontologie, l’animalisme élargit sa dimension morale au-delà de l’humanisme à l’ensemble du règne animal. Une de ses composants les plus récents, l’anti-spécisme, refuse la catégorisation des espèces animales selon des critères arbitraires établis en fonction des intérêts propres au genre humain, attitude relevant selon elle d’un anthropocentrisme responsable de la destruction du vivant. L’Holocène en cours, c’est-à-dire la disparition rapide et inédite de la majorité des espèces répertoriées sous l’action de l’activité humaine, donne à cette philosophie une force s’exprimant à travers un militantisme radical déstabilisant de nombreux aspects traditionnels propres à notre société : alimentation, élevage, agriculture, rapport au monde sauvage, développement urbain. Est-il possible pour notre espèce de redéfinir sa nature profonde, au-delà de la simple nécessité écologique de mettre un terme à l’élevage industriel ? Est-il possible de construire une altérité avec des formes de conscience animales qui ne sont pas semblables à la nôtre ? Une telle utopie, sorte de jardin d’Éden retrouvé, chassera-t-elle à nouveau Adam et Ève
du paradis ?
Bio-inspiration
Le génie humain est né d’une observation attentive du monde réel, que ce soit la nature ou les lois physiques sous-jacentes à son existence. Pourtant, les avancées technologiques, reposant sur une application abstraite de sciences comme la physique, la thermodynamique ou la chimie, ont délaissé les notions d’écosystème et d’interdépendance au profit d’une exploitation de ressources considérées comme illimitées. Ce début de XXIe siècle marque un retour brutal à la réalité dans lequel l’être humain comprend enfin la complexité et la fragilité de la planète qu’il habite. L’évolution des espèces végétales et animales et les solutions qu’elles ont déployé pour s’adapter à leur environnement nous offrent un modèle de développement harmonieux qui influence aujourd’hui l’architecture, le design et l’agriculture. La bio-inspiration rompt en apparence avec une modernité toute puissante, mais peut aussi devenir une simple esthétique justifiant la continuation d’une croissance industrielle destructrice. Sera-t-elle capable de modifier en profondeur la manière dont nous produisons et consommons, ou constitue-t-elle la dernière tentative que nous entreprenons pour masquer notre addiction à la consommation à outrance ?

Artiste et réalisateur multimédia. Diplomé de l’ENSAD Paris, réalisateur dans le domaine du motion design, il ouvre en parallèle sa pratique aux technologies numériques temps réel à travers la création de dispositifs muséographiques et artistiques. Il est co-fondateur de la société Active Creative Design.
Artiste et réalisateur multimédia. Diplomé de l’ENSAD Paris, réalisateur dans le domaine du motion design, il ouvre en parallèle sa pratique aux technologies numériques temps réel à travers la création de dispositifs muséographiques et artistiques. Il est co-fondateur de la société Active Creative Design.
